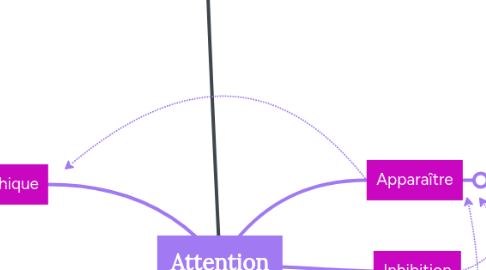
1. Conscience réflexive
2. Attention partagée
2.1. Modulations attentionnelles
2.1.1. Figure
3. Apparaître
3.1. Langage
3.1.1. Dynamique d'apparaître
3.1.2. Vigotsky
3.2. Ressources
3.2.1. > Romain Bigé Erwin Strauss, Merleau Ponty
4. Attention partagée
4.1. Différentes qualités d'attention partagées
4.2. Tonus
4.2.1. Accordage D.Stern
4.2.1.1. mélodie gestuelle ou vocale / amodale
4.2.1.1.1. Vittality affect
4.2.1.2. extrait Thèse Emma Bigé
4.2.1.2.1. « Dans _La première relation_ et surtout dans Le monde interpersonnel du nourrisson, il développe le concept d’« accordage » qui lui permet de décrire des échanges parents-enfants dont la fonction est, non pas certes l’échange de contenus verbaux de pensées (on imagine d’ailleurs difficilement ce que cela pourrait vouloir dire qu’un adulte et un nourrisson « pensent » verbalement la même chose), mais plutôt le partage de tonalités affectives. Ces tonalités affectives sont—comme le vocabulaire musical auquel Stern emprunte l’indique—des mélodies gestuelles ou vocales, des rythmes, des dynamiques. Elles existent sur un plan que Stern appelle « amodal », plan qui lui permet d’expliquer comment, par exemple, les parents accompagnent les gestes du nourrisson en sons ou inversement comment le nourrisson vocalise les gestes du parent : il n’y a pas là imitation ou traduction, mais habitation d’un monde dynamique commun qui existe en deçà de la distinction entre sonore et gestuel. Amodaux, les affects sont en deçà de la division des sens entre eux, en deçà de la localisation des sensations dans des organes des sens ou du geste dans des organes moteurs spécialisés : c’est tout le corps qui est concerné par ces affects, d’une manière non-localisée, sous la forme de variations du tonus musculaire, dont les deux pôles primordiaux sont la contraction (hypertonicité, quand le bébé a faim par exemple) et le relâchement (hypotonicité, dans la satiété). Ces affects amodaux, Stern les baptise du nom d’« affects de vitalité » (_vitality affects_) pour les distinguer de ce qu’on appelle généralement affect, à savoir des émotions ou des sentiments déjà catégorisés, comme la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la surprise, l’intérêt... « Par exemple, une “explosion” (_rush_) de colère ou de joie, l’expérience d’être inondé de lumière, l’accélération d’une séquence de pensées, une vague incommensurable de sentiment évoquée par de la musique, et une prise de narcotique peuvent tous être ressentis comme des ‘‘explosions’’. (...) La qualité ressentie de chacun de ces changements similaires est ce que j’appelle l’affect de vitalité d’une ‘‘explosion’’. » Les affects de vitalité sont des qualités dynamiques, dotées de certains « profils d’activation » typiques (aller _crescendo_, surgir, s’évanouir, exploser, s’allonger...). Curieusement, ces qualités sont plutôt exemplifiées par des verbes ou des adjectifs attachés à des phénomènes atmosphériques ou minéraux : surgir (comme la montagne), s’évanouir (comme le soleil derrière les nuages), exploser (comme les étoiles), s’allonger (comme les ombres). Cette provenance extra- humaine indique bien ce dont il est question : avec les affects de vitalité, Stern entend se placer dans un espace affectif qui précède non seulement la distinction entre les sens, mais aussi entre le sujet et l’objet. C’est en ce sens que le monde du nourrisson est relationnel (c’est-à-dire inter-cosmique) avant d’être interpersonnel (c’est-à-dire inter-humain). Avant l’interpersonalité, il y a une « relationalité » (relatedness), qui n’est pas la mise en lien de plusieurs « moi », mais le milieu commun d’où des soi émergent. parce que c’est un monde de relation, un monde où il n’y a pas un seul sens de soi, mais plusieurs ; un monde, autrement dit, où le soi au lieu d’être contenu dans les frontières du moi, n’a de cesse de fuir de tous côtés et de se déverser dans l’extériorité.
4.3. Nathalie Depraz
5. Fond
5.1. vigilance
5.1.1. Polarité
5.1.1.1. Geste Mineur
5.1.1.1.1. Affectes partagés
5.1.1.1.2. Expérience non duelle
5.1.1.2. Sujet
5.1.1.2.1. Schéma corporel
5.1.1.2.2. Image du corps
5.1.1.2.3. Pré-mouvement
6. Inhibition
7. Altérité psychique
8. Fenêtres attentionnelles
8.1. - saisie attentionnelle et maintient en prise - dé-saisie attentionnelle
9. Articulations fondamentales
9.1. Schiasme
9.1.1. Haut/bas
9.1.2. Avant/arrière
9.1.2.1. Sol Subjectif
9.1.2.1.1. Oeil
9.1.2.1.2. oeil
9.1.2.1.3. Dernière côte flottante
9.1.2.1.4. pied
9.1.2.1.5. pied
9.1.2.1.6. Oeil
9.1.2.2. Haptique
9.1.2.3. Oeil
9.1.3. Droite/gauche
10. sol objectif
10.1. Hapticité
11. Main
12. « sensibilité d’un individu au monde adjacent à son corps par l’usage de ce même corps » J.J Gibson
13. Entrelacements
14. Livres
14.1. Mouvements
14.1.1. mouvement du corps
14.1.1.1. « Chaque moment de veille fait appel à des sensations, non seulement de la vision, de l’ouïe, du goût, de l’odorat et du toucher, mais également à celles qui émanent de récepteurs situés dans les muscles, les articulations et la peau qui détectent la position, la force, et le mouvement dans une activité constante de l’organisme. […] Chacun perçoit afin de bouger et bouge afin de percevoir » Thelen E., « Motor development, a new synthesis », American… »
14.1.2. Pensées
14.1.3. Emotions
14.2. corps vécu / l’importance des croyances / des représentations /
14.2.1. exemple de Gorman sur le poids vécu
14.3. approches philosophiques
14.3.1. percevoir / explorer le monde / mouvement /
14.3.1.1. E.strauss
14.3.1.2. Merleau-Ponty
14.3.1.2.1. Chaire
14.3.2. attention comme préparation à l’action
14.3.3. affordance
14.3.3.1. J.J Gibson
14.3.4. D.Stern
14.3.4.1. Accordage/amodale
14.3.4.1.1. Vittality affect
14.3.5. Francesco Varela
14.3.5.1. Approche énactive
14.3.5.1.1. francisco varela, l'inscription corporelle de l'esprit
14.4. Apparaître /attention partagée
14.4.1. care
14.5. Toucher /être touché
14.5.1. réversibilité
14.5.1.1. schiasme
14.5.1.1.1. Miche Bernard
