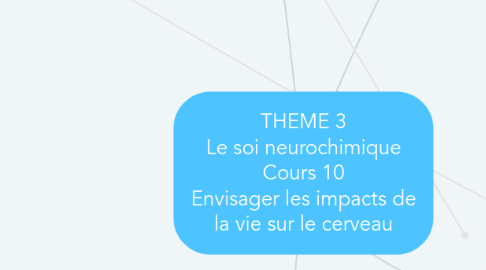
1. Paysage épigénétique
1.1. Une conceptualisation du l'humain depuis le milieu du XXeme siècle
1.1.1. Selon l'expérience de vie une ligne domine et sa trajectoire peut changer selon la force de certains évènements jusqu'à nous modifier au niveau cellulaire.
1.1.2. L'humain est en changement perpétuel, il ne peut redevenir ce qu'il a été.
1.2. L'épigénétique
1.2.1. C'est un pont entre génotype et phénotype
1.2.2. "Un phénomène qui change résultat final d'un locus ou d'un chromosome sans changer la séquence ADN sous-jacente" (Goldberg et coll, 2007)
1.2.3. Sa régulation
1.2.3.1. Le chromosome porte la chromatine, qui contient l'ADN qui porte les groupes methyl qui, portent les groupes acétyl
1.2.3.1.1. La chromatine peut changer selon
1.2.3.1.2. Les groupes méthyl et groupes acétyl peuvent changer selon
1.2.4. Publications (depuis 2000)
1.2.4.1. Intérêt pour la vie des ancêtres sur nos génomes
1.2.4.1.1. Lors de la transmission cellulaire de la mère à l'enfant beaucoup de traits épigénétiques disparaissent
1.2.4.1.2. La banque de cerveau de l'hôpital Douglas à Montréal a eu une grande importance dans les recherches sur l'épigénétique transgénérationnelle
1.2.5. L'humain est "plastique" (Turecki)
1.2.5.1. L'expérience traumatique ne s'ancre pas en chacun de la même manière dans la trajectoire de vie
1.2.5.2. Les ressources sont plus importantes au début de la vie face au traumatismes
2. Diathèse de stress
2.1. Observable selon 3 études
2.1.1. 1
2.1.1.1. Deux rates, deux portées
2.1.1.1.1. "Mauvaise mère" (indépendante de sa condition de femelle reproductrice et donc moins attentive !! conception culturellement située!!)
2.1.1.1.2. "Bonne mère" (attentive, !! conception culturellement située!!)
2.1.2. 2
2.1.2.1. Deux rates, deux portées
2.1.2.1.1. Inversion des portées
2.1.3. 3
2.1.3.1. Deux rates, deux portées
2.1.3.1.1. Traitement pour la réduction des groupes méthyl
2.2. TPSP
2.2.1. Créé lors de la publication du DSM-III
2.2.1.1. Suite aux séquelles des vétérants du Vietnam
2.2.1.1.1. Redéfinition de l'expérience traumatique
2.3. Rôle du temps
2.3.1. Les accidents de la vie permettent d'évacuer le souvenir : Le trauma perd du sens.
2.3.1.1. Change le regard sur le suicide
2.3.1.1.1. Il n'est plus le seul fait pathologique d'une succession de mauvais choix
2.3.1.2. Change le regard sur la vulnérabilité
2.3.1.2.1. Augmente le risque
2.3.1.3. Le trauma est dans le corps : L'expérience de vie est incorporée
2.3.2. Incompatible avec le regard du Douglas Hospital
3. Les études 1 et 2 ont des résultats à interpréter de paires "Même trajectoire épigénétique) : la génétique de prime pas, l'expérience de vie (et surtout l'enfance) est à relier aux profil ADN.
4. Doxa scientifique : il faut penser l'influence des politiques développementales internationnales (OMS, ONU, UNICEF...)
5. Épigénétique environnementale
5.1. Relie l'expression des gènes aux "évènements environnementaux" ou à "l'exposition".
5.2. L'humain est perméable à son milieu
5.2.1. Le milieu est donc interne ou externe, la limite des deux n'est pas bien définie
5.2.1.1. On parle d'"incorporation des expériences"
5.2.1.1.1. Il existe une mémoire des expériences
5.2.2. Les enfants traumatisés développent des capacités et des stratégies de réponses face au trauma.
5.2.2.1. Mais l'exposition à un milieu hostile change de manière durable
5.2.2.1.1. On ne redevient pas qui l'on a été
5.3. "Critical friendship" (Rose, 2020)
5.3.1. Sciences neurosociales
5.3.1.1. Neurosciences
5.3.1.1.1. Corps matériel
5.3.1.2. Sciences sociales
5.3.1.2.1. Corps symbollique
6. Anthropologie de la psychiatrie et des neurosciences
6.1. McGill Group for Suicide Studies
6.1.1. Interdisciplinaire
6.1.2. Leader dans le champs des neuroépigénétiques comportementales
6.1.3. Dirigé par g.Turecki
