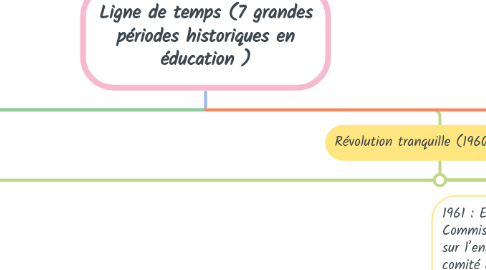
1. Lois
1.1. 1964 : Loi sur le ministère de l'éducation
1.2. 1967 : Loi constitutionnelle (article 93)
1.3. 1982 : Loi constitutionnelle (article 23 de la charte canadienne des droits et libertés)
1.4. 1988 : Loi sur l'instruction publique (LIP)
1.5. 1989 : Loi sur les établissements de niveau universitaire
1.6. 1992 : Loi sur l'enseignement privé
2. Régime Français (1608 @ 1760)
2.1. Pas d'organisation scolaire officielle, l'église est responsable de l'éducation dans la colonie
2.2. Seuls les Rois, nobles, le clergé et la bourgeoisie savent lire et seulement les notaires, gouverneurs et fonctionnaires savent lire
2.3. Éducation dispensée principalement aux garçons (1er apprentissage est la lecture afin de pouvoir lire la bible)
2.4. Apparitions des congrégations (Récollets, Jésuites, Ursulines) afin d'offrir une éducation au peuple
3. Régime Britannique (anglais) 1763 @ 1867
3.1. Plusieurs écoles disparaissent et aucune nouvelle école n'ouvre ses portes
3.2. De façon générale, on peut affirmer qu'au cours des quarante années qui ont suivi la Conquête, la situation de l'enseignement dans la nouvelle colonie anglaise n'a cessé de se détériorer. Le système d'enseignement existant s'écroule graduellement
3.3. Adoption des 4 grandes lois scolaire :
3.3.1. 1801 : l'institution royale - a pour but d'offrir une éducation de base à toute la population
3.3.2. 1824 : les écoles de fabriques - 1/4 des revenus de la paroisse est consacré à l'entretien d'une école et au salaire du maître
3.3.3. 1829 : les écoles de syndics - la chambre paie la moitié des coûts, le reste est assumé par les parents. Les plus pauvres y ont accès gratuitement (1828 : 1/15 enfants fréquentent l'école. 1832 : 1/3 enfants)
3.3.3.1. 1836 : fermeture de près de la moitié des écoles de syndics ; causée par un conflit à la chambre d'assemblée (les subventions ne sont plus accordées)
3.3.4. 1841 : la loi des municipalités - création des arrondissements scolaires et des commissions scolaires dans les villes (Québec et Montréal) - écoles communes qui accueillent tous les élèves sans préférences religieuses - l'église n'est pas satisfaite ; ceci amènera la création des écoles confessionnelles catholiques et protestantes
3.3.4.1. 1846 : loi qui crée les bureaux d'examinateurs et qui instaure la taxe scolaire.
3.3.4.1.1. 1851 : loi sur l'inspectorat des écoles, 23 inspecteurs sont nommés. Leur travail permet d'ouvrir plus d'écoles
4. Régime fédératif (1867 @ 1959)
4.1. Les provinces obtiennent le pouvoir exclusif de faire leurs propres lois en matière d’éducation
4.1.1. L'État souhaite retirer progressivement le pouvoir qu’a l’Église sur l’éducation
4.2. 1875 : nouvelle loi, conséquences :
4.2.1. Les responsabilités assumées par le surintendant, avant 1867, reviennent toutes à l’Église.
4.2.2. L’Église possède une entière liberté en matière d’éducation, le système scolaire catholique du Québec est entre ses mains.
4.2.3. L’Église n’est pas mal intentionnée, mais sa mission première (évangélisation, sauver les âmes) nuira à la scolarisation de la population québécoise. Les Québécois francophones deviendront malheureusement la population la moins bien scolarisée du Canada.
4.3. Le 20e siècle et ses changements :
4.3.1. Début de l'industrialisation, conséquence : urbanisation
4.3.2. La population francophone du Québec n’est pas suffisamment formée pour pouvoir exercer les métiers dont l’état a besoin et l'église ne souhaite pas la former en ce sens...
4.3.3. L’État tente de compenser le manque de formation de la population en créant des écoles spécialisées. Ex.: écoles d’agriculture, écoles supérieures de chimie, de foresterie, de commerce, etc
4.3.4. L’État ouvre également des instituts spécialisés pour répondre aux besoins spécifiques du marché du travail. Ex.: métiers de l’automobile, des textiles, des arts graphiques, du meuble, etc.
5. Révolution tranquille (1960 @ 1968)
5.1. Contexte social : Le système d’éducation se porte mal. Le Québec est la province la moins bien instruite au Canada. Les filles et les garçons n’ont pas accès au même parcours scolaire. Il est difficile d’accéder aux ordres d’enseignement supérieurs.
5.2. 1961 : la réforme en éducation, marquée par le rapport Parent, modifie en profondeur notre système d'éducation. Adoption d'une série de loi nommée la Grande Charte de l'éducation. C'est le début de la réforme en éducation, connue sous la réforme Parent
5.2.1. Loi qui institue la Commission royale d’enquête sur l’enseignement
5.2.2. Loi qui vise à faciliter la formation universitaire du personnel enseignant et de la recherche en éducation;
5.2.3. Loi qui met en place les régimes de prêts et bourses d’études aux étudiants des universités et des collèges classiques pour faciliter l’accès à ceux-ci
5.2.4. Loi qui oblige les commissions scolaires à donner l’enseignement secondaire aux enfants sous leur juridiction.
5.2.5. Loi qui décrète la gratuité de l’éducation et la fréquentation scolaire obligatoire jusqu’à 15 ans;
5.2.6. Loi qui décrète l’enseignement et les manuels scolaires gratuits du préscolaire à la fin du secondaire;
5.2.7. Loi qui crée les allocations scolaires, pour les parents dont les enfants de 16 et 17 ans sont encore aux études.
5.3. 1961 : En même temps que la Commission royale d’enquête sur l’enseignement, un autre comité d’étude est mis en place. De leur réflexion découlera le rapport Tremblay.
5.3.1. Il s’agit d’un comité d’étude portant sur l’enseignement professionnel et technique, présidé par Arthur Tremblay.
5.3.2. Le Comité Tremblay a pour mission de mettre de l'ordre dans le secteur de la formation professionnelle et technique, géré dans les faits par une multitude de ministères dont, entre autres, ceux de la Jeunesse, de l'Agriculture, des Mines et du Tourisme
5.4. Les francophones en général et les filles en particulier sont sous scolarisés. La Commission Parent et le Comité Tremblay travailleront dans la perspective d'augmenter l'accès à l'école de ces clientèles
5.4.1. 1962 : Publication du rapport Tremblay. On propose 4 niveaux de formation :
5.4.1.1. Initiation au travail
5.4.1.2. Métier
5.4.1.2.1. Rapport Parent : intégration dans les polyvalentes de la formation professionnelle, dispensée jusqu'alors dans les écoles de métiers;
5.4.1.3. Technique
5.4.1.3.1. Rapport Parent : transfert de la formation technique dans les collèges d'enseignement général et professionnel, les cégeps;
5.4.1.4. Universitaire
5.4.2. Les principes du rapport Parent:
5.4.2.1. Principe #1 : le droit à l’éducation pour tous.
5.4.2.1.1. Principe #2 : une formation adaptée aux besoins de chacun.
5.5. 3 finalités : Assurer l’égalité des chances, permettre à chaque enfant d’aller au maximum de ses possibilités. et assurer la préparation à la vie et 10 principales recommandations (voir PPT)
5.6. 1964 : La loi 60 est sanctionnée: c’est la création du ministère de l’Éducation du Québec [MEQ] et du Conseil supérieur de l’éducation [CSE].
5.7. Le rôle de l'église :
5.7.1. Des représentants de l’Église sont toujours présents dans les structures supérieures, mais de manière moins marquée. Ils sont chargés d’adopter: « des règlements sur l’enseignement religieux et moral pour assurer le caractère religieux des écoles, et de faire des suggestions » au Conseil supérieur de l’éducation sur les problèmes que pourrait soulever l’enseignement de certaines matières
6. Consolidation (1969 @ 1976)
6.1. On tente de mieux adapter les services éducatifs mis en place à la diversité de la clientèle et que l'on modifie quelques structures scolaires. En 1969 on ouvre les premières classes d'accueil pour enfants d'immigrants et l'UQAM ouvre ses portes
6.2. 1971 @ 1976 : plusieurs lois sanctionnées, rapport Nadeau, rapport Copex
6.3. Les commissions scolaires régionales ont créé des polyvalentes qui accueillent les élèves de la formation générale et professionnelle
6.4. Dès le début des années 1970, l'enseignement professionnel fait l'objet de plusieurs critiques. La formation reçue n'est pas reconnue par le marché du travail et les diplômés ont beaucoup de difficulté à se trouver un emploi relié à leur formation.
6.5. Après les rapports Parent et Tremblay
6.5.1. La gestion du personnel des écoles passe du ministère de l'Éducation aux commissions scolaires.
6.5.1.1. Les 3 500 personnes enseignantes concernées ont le choix de devenir fonctionnaires et d'être transférées dans un ministère ou d'intégrer les nouvelles polyvalentes ou cégeps.
6.5.1.1.1. Création de deux filières de la formation professionnelle : le professionnel court et le professionnel long
7. Consultation (1977 @ 1984)
7.1. 1976, seulement 26,7 % des diplômés du secondaire sortent de la filière professionnelle
7.1.1. La cohabitation des clientèles n'atténue pas les préjugés et les élèves se dirigent en moins grand nombre que prévu, vers l'enseignement professionnel.
7.2. 1977 : le projet de loi 101. Il fait de la langue française la langue officielle du Québec
7.2.1. *** 1977 : parution d'un document de consultation sur l'éducation intitulé l’enseignement primaire et secondaire au Québec: Livre vert
7.3. *** 1979 : Publication par le MEQ de deux parutions intitulées : Énoncé de politique et plan d’action pour l’enseignement primaire et secondaire (Livre orange)
7.3.1. 1979 : premiers changements pour la FP. Adaptation de l'enseignement professionnel aux élèves; le décloisonnement* (passerelles) de la formation professionnelle pour donner accès à une formation continue; la modernisation des équipements des écoles, etc.
7.4. 1981 @ 1983 : On propose alors d'admettre les élèves du professionnel long, en secondaire 5. Malgré cela, les discussions et les contestations se poursuivent.
7.4.1. Le gouvernement publie alors le Livre blanc, visant la relance de la formation professionnelle.
7.5. 1986 : le ministre de l’Éducation Claude Ryan qui modifiera finalement le parcours de la formation professionnelle grâce à une réforme importante visant essentiellement à rehausser la qualité de la FP.
7.5.1. Les programmes sont désormais élaborés ou révisés selon l'approche dite « par compétences », qui implique de décrire de façon opérafonnelle les compétences anendues au terme de la formafon
7.5.1.1. Finalement, cette réforme permet une rationalisation de l'offre des programmes de formation professionnelle en initiant des regroupements ainsi qu'une meilleure répartition géographique, afin de renforcer, entre autres, l'adéquation des différentes formations offertes, avec les besoins du marché du travail. Cela a notamment eu comme conséquence la mise sur pied des services aux entreprises (SAE) au sein des commissions scolaires.
8. De 1984 @ aujourd'hui
8.1. La réorganisation pédagogique (1985 @ 1995)
8.1.1. 1985 : Le ministère de l'Éducation se préoccupera dorénavant des ordres préscolaire, primaire et secondaire; le nouveau ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie aura juridiction sur l'enseignement collégial et universitaire, ainsi que sur la science et la technologie
8.1.2. 1986 : les États généraux sur la qualité de l’Éducation ont lieu. Propositions soumises aux enseignants afin d'améliorer les stratégies pédagogiques de ces derniers. Les restrictions budgétaires imposées laissent cependant les enseignants seuls face à ces défis importants.
8.1.3. 1990 à 1992 : c’est le début de la réforme concernant la formation des enseignants.
8.1.4. 1994 : le nouveau programme de formations des maîtres est approuvé et modifie grandement la formation de ceux-ci.
8.1.5. 1995 : c’est le début des États généraux sur l’Éducation.
8.2. États généraux et implantation de la réforme (1997 à 2007)
8.2.1. 10 chantiers prioritaires :
8.2.1.1. 1. Remettre l'école sur ses rails en matière d'égalité des chances; 2. Étendre et améliorer l'offre de services publics à la petite enfance; 3. Restructurer les curriculums du primaire et du secondaire pour en rehausser le niveau culturel; 4. Consolider la formation professionnelle et technique; 5. Procéder aux réorganisations nécessaires pour mieux répondre à la demande d'un enseignement supérieur de masse; 6. Traduire concrètement la perspective de formation continue; 7. Soutenir les principaux acteurs en vue de la réussite éducative ; 8. Redistribuer les pouvoirs pour renforcer le pôle local et l'ouverture à la communauté; 9. Poursuivre la déconfessionnalisation du système scolaire; 10. Garantir un financement qui permette l'atteinte des finalités éducatives.
8.2.2. 7 grandes lignes d'action :
8.2.2.1. 1. Intervenir dès la petite enfance; 2. Enseigner les matières essentielles; 3. Donner plus d’autonomie à l’école; 4. Soutenir l’école montréalaise; 5. Intensifier la réforme de l’enseignement professionnel et technique; 6. Consolider et rationaliser l’enseignement supérieur; 7. Donner un meilleur accès à la formation continue.
8.2.3. La réforme Marois :
8.2.3.1. 1997 : Pauline Marois présente l’énoncé politique « L’école, tout un programme ». Celui-ci propose un changement en profondeur des programmes du primaire et du secondaire.
8.2.3.1.1. 2000 : lancement de la réforme dont l’objectif est la réussite scolaire.
8.3. ''L’après réforme'' (2007 à aujourd’hui)
8.3.1. 2007 : mise en œuvre de la Stratégie d’action visant la persévérance et la réussite scolaires. On y prévoit hausser le taux de diplomation ou de qualification à 80 % chez les élèves de moins de 20 ans d’ici 2020
8.3.1.1. 2015 : le MELS devient le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur [MEES].
8.3.1.1.1. 2018 : lancement du Plan d’action numérique (MEES, 2018).
