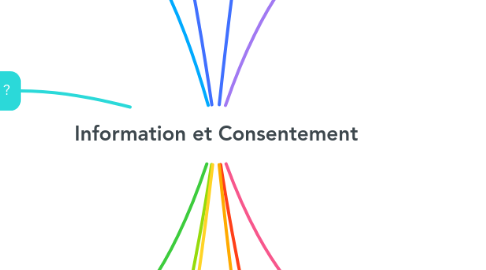
1. INFORMATION
1.1. LOYALE
1.1.1. NE PAS MENTIR
1.1.2. PAS DE FRANCHISE BRUTALE
1.1.2.1. PAS COMME LES ANGLOS SAXONS
1.2. CLAIRE
1.2.1. Doit être compréhensible
1.2.1.1. SIMPLIFIÉ POUR LE PATIENT
1.2.1.2. COMPRISE PAR LE PATIENT
1.3. APPROPRIÉ AUX CIRCONSTANCES
1.3.1. À la maladie elle même
1.3.2. TRAITEMENTS
1.3.2.1. ÉVITER LES INQUIÉTUDES
2. Qui DOIT INFORMER ?
2.1. Tt professionnelle de santé
2.1.1. L’ information incombe tt professionnel de santé
2.1.2. Multiplicité d’intervenant autour du patient
2.1.3. CHACUN DOIT INFORMER À SON NOUVEAU LE PATIENT ET FAIRE COMME SI L’AUTRE NE L’AVAIT PAS DONNÉ L’INFORMATION
3. QUI DOIT ÊTRE INFORMÉ ?
3.1. LE PATIENT
3.1.1. S’IL EST EN ÉTAT D’EXPRIMER SA VOLONTÉ
3.1.2. DANS UN ENTRETIEN INDIVIDUEL DIRECTE
3.2. Mineure
3.2.1. Information aux responsable légaux
3.2.2. Information au mineure
3.2.2.1. Données en fonction de son degré de maturité et de son âge
3.2.3. S’il souhaite le secret vis-à-vis de ses parents
3.2.3.1. Médecin peut mettre en place le traitement sans demander l’autorisation des parents
3.2.3.2. Mais celui ci doit être accompagne d’une personne majeur
4. La personne de confiance
4.1. Personne majeure
4.1.1. Cette personne peut être la personne à prévenir, mais PAS FORCÉMENT
4.2. Lors d’une hospitalisation
4.2.1. Ne vaut que pour UNE HOSPITALISATION
4.2.1.1. Désignation par ÉCRIT ET RÉVOCABLE
4.3. RÔLE
4.3.1. Témoin
4.3.1.1. Il peut témoigner pour le patient qui est incapable d’exprimer sa volonté
4.3.2. Ne se substitue pas au patient
4.3.2.1. DÉCISION FINALE REVIENT AU PATIENT
4.3.2.2. = si la personne de confiance donne un avis, il faut prendre en compte
5. ÉTENDUE DE L’INFORMATION
5.1. LA PLUS LARGE POSSIBLE
5.1.1. - Investigations à réaliser - Les traitements - Les actes de prévention et leur utilité - Le degré d'urgence à réaliser tel examen ou tel traitement - Les conséquences de faire/ne pas faire ( PRÉSENTER LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS ) - Présentation des risques • Fréquentse • Graves dans la mesure où ils sont normalement prévisibles - Les conséquences du refus - Les frais à supporter par le patient
6. PREUVE DE L’INFORMATION
6.1. INFORMATION,RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE
7. Consentement
7.1. Acte qui autorise le médecin ou le professionnel de santé à mettre en œuvre
7.1.1. Démarche diagnostique
7.1.2. Un traitement spécifique
7.1.2.1. Qu’il a au préalable expliquer au patient
7.2. Principe éthique pour le patient
7.2.1. Principe d’autodétermination
7.2.1.1. Faire un choix connaissance de cause
7.2.2. Principe du respect de l’intégrité physique
7.2.2.1. Autoriser la mise en œuvre du traitement sur son propre corps
7.2.3. Possibilité de refuser de subir la moindre intégrité corporelle
8. Consentement et relation Malade/medecin
8.1. Relation doit être
8.1.1. INÉGALE
8.1.2. ASYMÉTRIQUE
8.2. Médecin
8.2.1. Position de domination naturelle
8.2.1.1. Statut
8.2.1.2. Connaissance = savoir
8.2.2. Présente d’un aréopage
8.3. Patient
8.3.1. État de diminution
8.3.1.1. Par la douleur, angoisse, inquiétude
8.3.2. Raison à son inquiétude
8.3.2.1. La perte d’autonomie
8.3.2.2. La perte de repère à l’hôpital
8.3.2.3. Les examens
8.4. IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION
8.4.1. Rétablir l’asymétrie entre les humeurs du patient et du médecin
8.5. Procédure
8.5.1. 3 conditions
8.5.1.1. INFORMATION
8.5.1.2. CARACTÈRE VOLONTAIRE DU CONSENTEMENT
8.5.1.2.1. Consentement libre de tt contrainte extérieur
8.5.1.3. LE FAIT D’UNE PERSONNE CAPABLE JURIDIQUEMENT
8.5.1.3.1. LE CONSENTEMENT PEUT ÊTRE RETIRÉ À TT MOMENT
9. CONSENTEMENT IMPLICITE
9.1. ACCEPTATION AUTOMATIQUE DU PATIENT AUX SOINS PROPOSÉS
9.2. QUAND C’EST CLAIR, SANS AMBIGUÏTÉ, PAS DE DIFFICULTÉ
9.3. 3 attitudes que le consentement implicite peut cacher
9.3.1. ACCEPTATION
9.3.2. L’INDIFFÉRENCE
9.3.2.1. Hospitalisation en urgence
9.3.3. LE REFUS
9.3.3.1. Souvent traduit par l’angoisse, la violence SANS consentement
10. Consentement EXPLICITE
10.1. Utilisé si l’interlocuteur est mal à l’aise à cause d’un texte de loi
10.2. ESSAIS THÉRAPEUTIQUE
10.3. EXPRERIMENTATIONS
10.4. THÉRAPEUTIQUE DIFFICILLE
10.5. ENSEIGNEMENT CLINIQUES
11. LOI KOUCHNER
11.1. LOI du 4 Mars 2002
11.1.1. Possibilité d’accéder aux informations
11.1.1.1. La règle du secret s’impose pas à ce que des informations soient délivrés aux AYANT DROIT
11.1.1.1.1. SAUF VOLONTÉ expresse de la personne
11.1.2. 3 circonstances
11.1.2.1. Connaître les causes de la mort
11.1.2.2. Défendre la mémoire du défunt
11.1.2.3. Faire valoir leur droits
