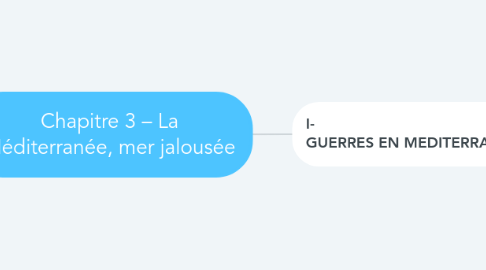
1. I- GUERRES EN MEDITERRANEE
1.1. A- Charles Quint (1500-1558) et le rêve d’un Empire universel
1.1.1. Charles Quint (1500-1558) est l’héritier des Rois catholiques, des ducs de Bourgogne et des Habsbourg en Europe centrale. Il est le dernier Empereur du Saint-Empire qui puisse prétendre à un pouvoir universel, en raison de l’ampleur de ses héritages Par élection, il devient Charles Quint en 1519 : il est le cinquième Charles (= Charles V) élu Empereur du Saint-Empire romain germanique.
1.1.2. Il a une très haute idée de sa mission : unifier la chrétienté, lutter contre tous les ferments d’hérésie, de dissension.
1.1.3. Ce rêve d’Empire universel se heurte à deux rivaux en Méditerranée : la France, dans la péninsule italienne ; l’Empire ottoman, en Méditerranée et en Europe centrale
1.2. B- Les guerres d’Italie (1494-1559
1.2.1. Morcellement politique. Principautés et Républiques
1.2.1.1. L’Italie n’existe pas comme État unifié à l’époque moderne. Son unité culturelle est perçue ; son unité politique date de 1871
1.2.1.1.1. Au nord le duché de Milan, aux mains des Sforza, la République de Venise et la République de Florence, qui devient un duché au XVIe siècle, sous domination des Médicis.
1.2.1.1.2. - Au centre, les États de l’Église. Le pape est un monarque élu. Il est le chef spirituel de l’Église chrétienne et un chef d’État. Il est élu par le collège des cardinaux, réunis en conclave, dans une salle fermée à clé (cum clave : « conclave ») pour le temps de l’élection.
1.2.1.1.3. - Au sud, Sardaigne, Naples et la Sicile, trois royaumes conquis au Moyen Âge par les Aragon et passés à Charles Quint, héritier de Ferdinand d’Aragon.
1.2.2. Des batailles pour l’Europe
1.2.2.1. L’élément déclencheur est dynastique. Le roi de France revendique des droits sur le royaume de Naples, le duché de Milan et la Savoie. L’Italie est le principal champ de bataille européen dans la première moitié du XVIe siècle. Les conflits s’enchaînent sans interruption de 1494 à 1530. Ils opposent les Habsbourg aux rois de France, avec leurs alliés respectifs, et se prolongent jusqu’à la paix du Cateau-Cambrésis (1559).
1.2.2.1.1. Les Français subissent une lourde défaite à Pavie (1525). contre les espagnolsCette paix sous tutelle de l’Espagne (pax hispanica) garantit l’équilibre en Italie. Les Habsbourg possèdent désormais le duché de Milan, en plus de Naples, de la Sicile et de la Sardaigne.
1.2.2.1.2. La mort prématurée d’Henri II en 1559 est lourde de conséquence dans l’histoire de France. Ses fils sont encore des enfants. Une période de régence s’ouvre, exercée par Catherine de Médicis
1.2.3. L’Italie à feu et à sang
1.2.3.1. Le sac de Rome interrompt les grands chantiers lancés par les papes Jules II et Léon X . En réalité, la crise a débuté quelques années auparavant, par la peste de 1522. Les artistes prennent la fuite, ailleurs en Italie ou en Europe. Il faut attendre une bonne décennie avant que Rome ne regagne sa population et son prestige, mis à mal par le saccage.
1.2.3.1.1. le sac de Rome 1527
1.2.4. Naissance de la guerre moderne
1.2.4.1. -- Déclin de la chevalerie.
1.2.4.1.1. La généralisation des armes à feu est en rupture avec les formes de combat traditionnel et avec l’idéal chevaleresque. L’issue du combat ne dépend plus du défi singulier entre deux chevaliers, au corps à corps, mais d’une stratégie collective avec armes à feu. L’artillerie rend l’affrontement impersonnel ; l’héroïsme chevaleresque décline.
1.2.4.2. -- Montée de l’infanterie.
1.2.4.2.1. Les troupes de cavalerie voient leur importance reculer à partir du XVIe siècle. Les hommes à pied, les troupes d’infanterie, jouent un rôle crucial dans les batailles. Pour être efficaces, il faut qu’ils soient très nombreux.
1.2.4.3. -- Développement des armes à feu :
1.2.4.3.1. l’artillerie joue un rôle décisif dans l’issue des conflits. Ce sont des armes portatives, comme l’arquebuse (explosion d'une charge de poudre allumée une violence inédite interrompt plusieurs décennies de transformation de la ville éternelle. Il est comparé au sac de Rome
1.2.4.4. -- Du ban féodal à la conscription.
1.2.4.4.1. Au Moyen Âge, la plupart des armées sont constituées de mercenaires. Les compagnies sont des troupes de cavalerie lourdement armées, mobilisées au titre du ban et de l’arrière-ban dû à un seigneur.
1.2.4.5. -- Puissance de l’infanterie espagnole
1.2.4.5.1. Les premiers régiments d’infanterie sont organisés autour de 1500. Ils constituent la base de la puissance militaire de la Castille. La conscription permet à la Castille de disposer de troupes d’infanterie considérables, les tercios, régiments de 2500 soldats. L’infanterie est armée de piques, qui repoussent les attaques frontales des cavaliers, et d’arquebuses, pour tuer à distance.
1.2.4.6. -- Guerre de siège
1.2.4.6.1. Il faut donc développer de nouveaux systèmes défensifs. Les ingénieurs sont en charge de moderniser les forteresses. Ils développent le tracé à l’italienne. Les fortifications sont conçues pour offrir le moins de prise possible à l’artillerie, par les bastions, des murs à pans inclinés qui ralentissent les projectiles et la création de plusieurs lignes de défense.
1.3. C- La Méditerranée ottomane
1.3.1. L’Empire ottoman, à vocation universelle
1.3.1.1. Fondé en 1299 et dissous en 1922, l’Empire ottoman (du nom du premier souverain, Osman) est l’une des plus vastes constructions politiques de l’époque moderne. À la fin du XVIe siècle, il s’étend sur trois continents : Europe, Afrique et Asie
1.3.1.2. -- De Byzance à Istanbul
1.3.1.2.1. La prise de Constantinople en 1453 par les troupes de Mehmet II « le Conquérant » permet aux Ottomans de faire de l’ancienne capitale byzantine leur capitale, Istanbul. Par la prise des derniers vestiges de l’Empire byzantin, les Ottomans accroissent leur présence militaire en mer Noire et contrôlent les routes de la soie.
1.3.1.3. -- Extension en Orient et en Afrique du Nord
1.3.1.3.1. ils s’implantent sur le continent africain : à Alger (1519), Tripoli (1551) et Tunis (1574). Par la conquête de la Syrie, de la Palestine et de l’Égypte, ils font entrer dans l’Empire ottoman les villes saintes de La Mecque et de Médine.
1.3.1.4. -- Le sultan, « ombre de Dieu sur les terres »
1.3.1.4.1. Sultan : titre donné par le calife (successeur du prophète Mahomet) à un chef militaire et porté par différents monarques du monde islamique, dont le souverain ottoman. - Le sultan ottoman est ghazi (combattant de la foi) et législateur. Il est secondé par le grand vizir. Son armée puissante constitue la force de l’empire, avec son administration centralisée.
1.3.1.4.2. L’empire est l’anthitèse de l’etat-nation. Les ethnies y sont multiples. Religion off de l’emp est sunnite, juif, chrétien -> commercent en vertu du système de la dhimma
1.3.2. L’Empire dans sa grandeur. Le règne de Soliman le Magnifique (1520-1566)
1.3.2.1. Le règne de Soliman Ier (1520-1566) est jalonné de conquêtes et aboutit à l’Empire ottoman dans sa plus grande expansion. Contemporain de Charles Quint, il est le plus célèbre des souverains ottomans, connu sous le surnom de « Magnifique » en Occident, il est « le Législateur » pour les Turcs. Avec Charles Quint, l’affrontement est inévitable
1.3.2.2. -- Une politique de conquêtes
1.3.2.2.1. Belgrade est prise en 1521, Rhodes, dernier bastion des chrétiens en Méditerranée orientale, conquise en 1522, ce qui met un terme au dernier État chrétien d’Orient né des croisades et oblige l’ordre des Hospitaliers à s’installer à Malte. Cette conquête décisive permet aux Ottomans de dominer toute la Méditerranée orientale.
1.3.2.2.2. La flotte ottomane domine la Méditerranée orientale. Elle se lance dans des incursions dans le bassin occidental. En 1565, les Ottomans échouent à s’emparer de Malte, verrou de la Méditerranée occidentale où se sont installées les Hospitaliers après avoir été chassés de Rhodes
1.3.2.2.3. En 1529, Soliman échoue à s’emparer de Vienne, au cœur des États des Habsbourg d’Autriche. Le siège de Vienne marque le point ultime de l’avancée des Ottomans en Europe centrale
1.3.3. Rapports avec les princes chrétiens
1.3.3.1. L’Empire ottoman représente une menace grandissante aux yeux des puissances européennes, épouvantées par la prise de Constantinople (1453) et le siège de Vienne (1529).
1.3.3.2. -- Croisade contre croisade.
1.3.3.2.1. - Au Moyen Âge, la croisade a pour but la reprise de Jérusalem et des Lieux saints en Palestine, de Jérusalem. Le temps des croisades est terminé depuis la fin du XIIIe siècle. - À l’époque moderne, le pape continue à appeler à reconquérir Jérusalem, mais son appel est de plus en plus symbolique. La croisade n’a plus un sens géographique précis. Elle a lieu partout où l’Empire ottoman menace de s’étendre
1.3.3.3. L’alliance franco-turque
1.3.3.3.1. La croisade est un puissant moteur des guerres entre l’Empire ottoman et les princes chrétiens au XVIe siècle. Néanmoins, elle coexiste avec des alliances stratégiques. Ainsi, la France et l’Empire ottoman, ennemis par principe, s’entendent contre les Habsbourg.
1.3.3.3.2. Soliman Ier et François Ier partagent seulement un adversaire redoutable : Charles Quint. L’alliance dérive d’une estimation des rapports de force entre princes chrétiens. L’alliance n’est pas un acte d’amitié avec la France, mais un acte d’hostilité aux Habsbourg.
1.3.4. Guerre sur mer. La course, la bataille de Lépante (1571)
1.3.4.1. -- Course barbaresque, course chrétienne
1.3.4.1.1. La guerre de course barbaresque est aux mains de corsaires musulmans. Elle vient en appui de la flotte de guerre de l’Empire ottoman.
1.3.4.1.2. La Sainte-Ligue est une alliance militaire contre l’Empire ottoman, formée à l’initiative du pape Pie V, réunissant les États de l’Église, l’Espagne de Philippe II, Venise, Gênes, les chevaliers de Malte. Elle répond à la menace croissante des Ottomans en Méditerranée, en particulier à des attaques à Chypre. Les deux flottes se rencontrent dans le golfe de Patras.
1.3.4.2. opposant 213 galères espagnoles et vénitiennes, sous commandement de Don Juan d’Autriche (demi-frère de Philippe II) à près de 300 navires turcs commandés par Ali Pacha. C’est la dernière bataille de galères, ce navire typique de la Méditerranée qui existe depuis l’Antiquité. En tout, plus de 500 navires et 180 000 hommes s’affrontent. Les pertes sont énormes, à la mesure des forces engagées
1.4. D- L’échec d’un empire universel : abdication de Charles Quint et division de l’Empire
1.4.1. Assailli de toutes parts par les guerres qui minent l’Empire chrétien rêvé, Charles Quint en vient à la décision d’abdiquer. Il se retire dans le monastère de Yuste en Estrémadure, après s’être dépossédé de l’ensemble de ses couronnes, en 1555 et 1556, au bénéfice de son fils Philippe II, héritier des couronnes espagnoles, des Indes et des Pays-Bas. Son frère cadet Ferdinand Ier devient Empereur et hérite des possessions d’Autriche.
1.4.2. L’Empire de Charles Quint est partagé à la moitié du XVIe siècle entre les possessions espagnoles (qui incluent Milan, Naples, les Pays-Bas et les Indes) et les possessions autrichiennes, en Europe centrale. L’Empire espagnol de Philippe II reste d’une étendue considérable Désormais, la maison des Habsbourg se divise en deux : les Habsbourg d’Espagne et les Habsbourg d’Autriche.
