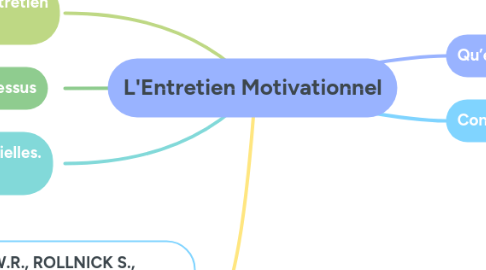
1. MILLER W.R., ROLLNICK S., L’entretien motivationnel – Aider la personne à engager le changement, trad. par LECALLIER D., MICHAUD P., Paris, InterEditions, 2013, p. 17
2. L’esprit de l’entretien motivationnel
2.1. etat d'esprit
2.1.1. s’appuie sur les motivations intrinsèques formulées.
2.1.2. La relation vise à augmenter la motivation au changement
2.1.3. atmosphère empathique et valorisante.
2.1.4. orienté vers un objectif déterminé, il est directionnel.
2.1.5. l’entretien est centré sur la personne
2.2. Le partenariat
2.2.1. L'EM est à envisager comme la collaboration entre deux experts
2.2.1.1. Le professionnel expert dans son domaine
2.2.1.2. La personne experte de sa propre situation
2.3. Le non-jugement
2.3.1. Reconnaître la valeur inconditionnelle de chaque être humain et son potentiel
2.3.2. Manifester une empathie approfondie pour le point de vue de l’autre
2.3.3. Respect et soutien de l’autonomie de la personne
2.3.4. Valoriser ses capacités et ses efforts
2.4. L’altruisme
2.4.1. l’intérêt qui prévaut doit rester celui de la personne accompagnée
2.4.1.1. « Être altruiste, c’est promouvoir de façon active le bien-être de l’autre, donner la priorité aux besoins de l’autre »
2.5. L’évocation
2.5.1. La personne a en elle les ressources pour changer = les faire émerger
3. Les principes. Les 4 processus
3.1. L’engagement dans la relation
3.1.1. Création d'une alliance thérapeutique
3.1.1.1. notion d’objectifs communs et de moyens négociés
3.1.2. l’établissement d’une « relation fondée sur la confiance mutuelle et sur une aide respectueuse »
3.1.2.1. La rencontre correspond-t-elle a ce qu’elle souhaite, à ce qu’elle en attend ? Est-ce important pour elle ? L’a-t-elle vécue positivement et y voit-elle un espoir de changement ?
3.1.3. savoir écouter
3.1.3.1. comprendre ce qui créé l’ambivalence
3.1.4. savoir explorer
3.1.4.1. valeurs et désirs
3.1.4.1.1. questions ouvertes, les reflets, la valorisation et les résumés
3.2. La focalisation
3.2.1. s’accorder avec la personne sur la direction visée par l’accompagnement
3.2.1.1. être directif, d’essayer d’indiquer à la personne une direction à suivre
3.2.1.2. non-directif (Rogers) propose de laisser la direction de l’accompagnement au libre arbitre du client
3.2.1.3. Guider la détermination du cap à viser
3.2.1.3.1. prendre en compte les attentes de la personne, le contexte, et les perceptions de l’intervenant
3.3. L’évocation
3.3.1. Amener la personne à verbaliser ses propres arguments et motivations à changer
3.3.1.1. Susciter le discours-changement
3.3.1.2. Explorer l'ambivalence
3.4. La planification
3.4.1. lorsque le discours-changement de la personne bascule dans un mode de mobilisation
3.4.1.1. Renforcer l'engagement
3.4.1.2. Formuler un plan d’action
3.4.1.3. Faire émerger : motivations propres, capacités et moyens
3.4.1.4. Apporter de l’information
3.4.1.5. Différentes stratégies pourront être proposées
4. Les compétences essentielles. (OuVER)
4.1. Poser des questions ouvertes
4.1.1. Laisse une grande liberté d’élaboration à la personne, l’amène à réfléchir et à s’exprimer
4.1.1.1. Le discours de la personne est au centre de l’échange
4.2. Valoriser
4.2.1. Reconnaître explicitement ce qui est bon, soutenir et encourager
4.2.1.1. sincère, authentique
4.2.2. favorise l’engagement dans la relation
4.3. L’écoute réflective
4.3.1. « non-verbal » important pour signaler notre intérêt, notre attention, refléter ce qui est dit
4.3.2. Empathique avec l’émotion ressentie
4.3.3. les réponses du praticien doivent permettre l’introspection.
4.3.3.1. Impasses relationnelles
4.4. Résumer
4.4.1. valider que vous avez bien compris
4.4.2. permet à la personne de porter un regard sur ce qu’elle a dit,
5. Qu’est-ce que c’est ?
5.1. L’entretien motivationnel est un style de conversation collaboratif permettant de renforcer la motivation propre d’une personne et son engagement vers le changement
5.2. William R. Miller, Stephen Rollnick, psychologues définissent ainsi cette forme d’entretien qu’ils ont conceptualisée au cours des années 80 pour le traitement des dépendances à l’alcool.
5.3. adapté dans les situations où une personne est ambivalente face à un changement de comportement donné, comportement dont le maintien a déjà, ou pourrait avoir des conséquences importantes sur sa santé où sa situation sociale.
5.3.1. les professionnels de l’aide, poussés par le désir d’aider l’autre et influencés par leurs propres représentations, peuvent avoir tendance à formuler à la place de la personne des arguments en faveur du changement
5.3.1.1. = Réflexe correcteur
6. Concepts autour de l’EM
6.1. L’ambivalence
6.1.1. Etre ambivalent, c’est ne pas réussir à prendre une direction. C’est à la fois vouloir et ne pas vouloir changer
6.1.2. débat interne vif entre le statut-quo et le changement.
6.2. Le réflexe correcteur
6.2.1. Développer (le thérapeute) les arguments en faveur du changement
6.2.2. tenter de convaincre
6.2.2.1. On lui impose notre point de vue, on la prive de son autonomie
6.2.3. ce faisant, on obtient souvent l’inverse de ce que l’on cherchait.
6.3. La dissonance
6.3.1. opposition entre l’intervenant et le client
6.3.2. discours tourné vers l’intervenant
6.3.3. manière d’intervenir, trop frontale et directive, qui provoque cette forme de résistance
6.4. Le Discours Maintien et Le Discours Changement
6.4.1. discours-maintien
6.4.1.1. l’expression du client des raisons qui l’empêchent d’aller vers un changement de comportement
6.4.2. discours-changement
6.4.2.1. l’ensemble des assertions du client en faveur du changement
6.4.2.2. préparatoire
6.4.2.2.1. discours indiquant :
6.4.2.3. De mobilisation
6.4.2.3.1. différents niveaux (engagement, activation, premiers pas)
